Texte publié dans la revue Rando Québec d’hiver 2017
Les randonneurs qui agrémentent leurs promenades en forêt par des cueillettes de champignons sauvages sont contraints à mettre fin à cette activité l’hiver, car, c’est bien connu, les champignons, ça ne pousse pas sous la neige! Fine observation, car effectivement les champignons ne se cueillent pas l’hiver… sauf un! Un champignon qui est parfois nommé le « roi des champignons médicinaux » ou le « diamant des forêts », qui résiste à la froidure et qui se démarque nettement de la blancheur environnante par son excroissance de couleur noire bien accrochée aux bouleaux d’un âge vénérable : le chaga.
Le polypore oblique (Inonotus obliquus), mieux connu sous son nom russe, chaga, est un champignon qui pousse sur les arbres de la forêt boréale et qui est réputé avoir des propriétés médicinales exceptionnelles. Ce champignon dur comme du bois est reconnaissable par son excroissance qui a l’apparence de bois brûlé ou de charbon, et qu’on retrouve sur les bouleaux blancs et les bouleaux jaunes. Il ne faut pas confondre le chaga avec le polypore amadouvier (Fomes fomentarius) qui, lorsqu’il se dégrade, peut avoir une couleur noire. Il est utilisé depuis des temps immémoriaux comme allume-feu. Le polypore amadouvier a la forme d’un sabot de cheval, alors que la croûte extérieure du chaga est plus crevassée, moins lisse et uniforme.

On ne consomme pas le chaga comme on consomme les autres champignons. On ne le mange pas; on le boit plutôt après en avoir fait une décoction. En Russie, il est utilisé en médecine naturelle depuis le XVIe siècle, notamment dans les traitements contre le cancer, ou simplement utilisé comme succédané du thé ou du café. La décoction a un délicieux – mais discret – goût boisé, avec une légère amertume et une finale de sirop d’érable.
Des propriétés médicinales exceptionnelles
Le chaga est considéré comme le plus puissant antioxydant connu. Il aurait des propriétés antitumorales, anti-inflammatoires et stimulerait le système immunitaire.
C’est un des champignons les plus étudié par les scientifiques. Selon J.-André Fortin, chercheur au Centre d’études de la forêt de l’Université Laval, le chaga contient beaucoup d’antioxydants et des polyphénols qui aident à éliminer les radicaux libres impliqués dans la genèse du cancer. Son efficacité anticancer serait plus préventive que curative, mais beaucoup reste à découvrir sur les vertus du chaga.

Comment le récolter, le conserver et le consommer
On ne cueille le chaga que durant la saison froide, c’est-à-dire après la chute des feuilles et avant qu’elles ne repoussent, car il est alors plus concentré en molécules actives ayant un effet médicinal. C’est donc en étant prêt à braver le froid qu’on enfile ses bottes ou ses raquettes et qu’on se dirige vers les forêts de bouleaux. On trouvera alors le chaga sur les bouleaux blancs et les bouleaux jaunes, généralement dans des forêts âgées, car c’est un champignon parasite qui s’installe sur une blessure de l’arbre. À terme, il le tuera. On « cueille » le chaga avec une hache ou une scie en prenant soin de ne pas endommager le bois de l’arbre, tout en laissant environ 15 à 20 % de la masse du chaga sur l’arbre. Il poursuivra alors sa croissance et on pourra faire une autre récolte quelques années plus tard.
Quand on revient à la maison avec sa récolte, on la fait sécher rapidement près du poêle à bois ou d’une source de chaleur, ou encore dans un déshydrateur; cela afin d’éviter que les moisissures ne s’installent. L’extérieur du chaga a l’apparence d’une croûte noirâtre qui ressemble à du charbon, mais l’intérieur varie de jaune doré à orangé ou brun. Après avoir fait sécher le chaga (il perdra alors 50 % de son poids), on le taille en petits morceaux d’environ 16 cm3 (1 po3). Les petits éclats qui résultent de la taille peuvent être moulus dans un moulin à viande ou un moulin à café. On est alors prêt à se faire une décoction avec les morceaux ou la poudre de chaga. On conserve le chaga sec dans des contenants hermétiques à l’abri de la lumière.
Quantité : environ 10 g de chaga (une cuillère à table) pour un litre d’eau.
On amène l’eau à ébullition, puis on baisse la température et on ajoute le chaga moulu. On laisse frémir 15 minutes, puis on filtre et on déguste. Certains préfèrent laisser mijoter une heure, voire deux heures ou plus. On peut infuser le chaga moulu de deux à trois fois.
Quantité : environ 10 g de chaga (deux morceaux) pour un litre d’eau.
On amène l’eau à ébullition, puis on baisse la température et on ajoute les morceaux de chaga. On laisse frémir 30 minutes, puis on filtre et on déguste. Certains préfèrent laisser mijoter une heure, voire deux heures ou plus. On peut réutiliser les morceaux de chaga, qu’on a fait sécher entre leur utilisation, de trois à quatre fois.
La décoction peut se conserver quelques jours au réfrigérateur. Le chaga n’est pas recommandé pour les personnes hypoglycémiques ou souffrant de diabète de type 1. Les autres personnes peuvent en consommer à volonté. Le sirop d’érable se marie bien au goût du chaga.
Un champignon qui prend sa place dans la gastronomie du Québec
La décoction de chaga est de plus en plus utilisée par les chefs du Québec dans leurs recettes aussi bien sucrées que salées. Un brasseur de bière (Brasserie Générale) a même conçu une bière noire avec ce champignon, la Chaga. On cuisine toujours avec la décoction de chaga, jamais avec le champignon lui-même. Par contre, on peut utiliser les morceaux de chaga comme encens après les avoir utilisés pour en faire des décoctions!
Voici quelques façons d’utiliser la décoction de chaga, expérimentées par des chefs à travers les grandes tables du Québec : risotto au chaga, panna cotta au chaga, crème brûlée et crème glacée au chaga, chocolats chauds au chaga, marinades pour gibiers, etc. Les idées ne manquent pas! De quoi apprêter un délicieux repas après une belle journée de randonnée en raquettes… au milieu d’une forêt de bouleaux!
Cueillette aux bons endroits
On fait de la cueillette en des endroits éloignés des sources de pollution. Si on souhaite en faire sur des terres privées, il va sans dire qu’on demande l’autorisation aux propriétaires. Il est permis de faire de la cueillette dans les ZEC et certains parcs régionaux, ainsi que sur les terres publiques. C’est permis également dans les pourvoiries privées en terres publiques, mais on doit s’enregistrer auparavant. La cueillette est interdite dans les parcs nationaux, les réserves écologiques, les zones de conservation et les aires protégées.

François Patenaude
François Patenaude, est propriétaire de Saveurs des bois, une entreprise de cueillette et de culture de Produits forestiers non ligneux (PFNL) et de petits fruits émergents. Depuis 2014, il est responsable du développement des produits forestiers comestibles à l’Abbaye Val Notre-Dame et membre du CA du Club des producteurs de noix comestibles du Québec (CPNCQ), dont il est vice-président depuis 2019. Avant de parcourir les forêts, il a notamment été président du Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE), membre fondateur de l’Institut de recherche et d’information socio-économique (IRIS), ainsi que de l’Association québécoise pour le contrat mondial de l’eau (AQCME) et chercheur à la Chaire d’études socio-économiques de l’UQAM. Il a également été membre du groupe d’humour politique les Zapartistes pendant plus de 15 ans.
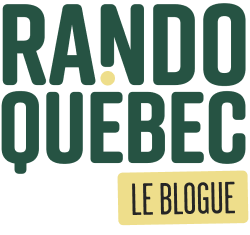
5 commentaires
Bonjour,
Je m’adresse à vous pour savoir si on peut congeler des champignons surtout les polypodes récoltés après avoir gelés tels que le reishi, polypodes multicolores et pleurotes que j’ai mis au congélateur après cueillette car ils avaient gelés durant la nuit
Merci pour les infos, nous sommes propriétaires d’une érablière à bouleau. Je ne connaissais pas ce champignon.
Bonjour,
J’ai trouvé un chaga sur ce qui semble être un érable. Est-ce possible?
J’aimerais vous envoyer des photos… à quelle adresse puis-je le faire?
Merci
Nadine
Bonjour, sur mon terrain boisé, je crois bien avoir repéré un chaga mais il est petit. La grosseur d’un oeuf environ. Dois-je le laisser grossir et si oui, combien de temps?
J’ai trouvé un chaga polypore « amadouvie »r noir sur un bouleau mort. Je devine qu’il est vieux. Grosso modo mido comme un fer à cheval ou une demie-lune.
Si je comprends bien, le polypore qui nous intéresse, celui aux vertus très spéciales, serait « l’Oblique ». Il serait sans forme, comme sur les photos…Et plutôt noir aussi.
Ai-je bien compris ?